Ait youcef ouali
Cette page est composée des parties suivantes :- Mohammed Harbi: la guerre d’Algérie a commencé à Sétif
- Mohamed Harbi : les violences de la guerre d’indépendance algérienne
- condamnation du général Aussaresses pour "apologie de crimes de guerre"
- la bataille d’Alger, par Benjamin Stora
- condamnation du général Aussaresses pour "apologie de crimes de guerre"
- Extraits de l’entretien d’Annie Rey-Goldzeiguer [1] avec Christian Makarian et Dominique Simonnet, publié dans l’Express du 14 mars 2002.
- torture : ce que j’ai vu en Algérie, par Jacques Julliard
- la guillotine et la guerre d’Algérie
Mohammed Harbi : “la guerre d’Algérie a commencé à Sétif”
Le 8 mai 1945, tandis que la France fêtait la victoire, son armée massacrait des milliers d’Algériens à Sétif et à Guelma. Ce traumatisme radicalisera irréversiblement le mouvement national.
Cet article de l’historien Mohammed Harbi, auteur, avec Benjamin Stora, de La Guerre d’Algérie, 1954-2004, la fin de l’amnésie [1], a été publié dans Le Monde diplomatique de mai 2005.
Désignés par euphémisme sous l’appellation d’« événements » ou de « troubles du Nord constantinois », les massacres du 8 mai 1945 dans les régions de Sétif et de Guelma sont considérés rétrospectivement comme le début de la guerre algérienne d’indépendance. Cet épisode appartient aux lignes de clivage liées à la conquête coloniale.
La vie politique de l’Algérie, plus distincte de celle de la France au fur et à mesure que s’affirme un mouvement national, a été dominée par les déchirements résultant de cette situation. Chaque fois que Paris s’est trouvé engagé dans une guerre, en 1871, en 1914 et en 1940, l’espoir de mettre à profit la conjoncture pour réformer le système colonial ou libérer l’Algérie s’est emparé des militants. Si, en 1871 en Kabylie et dans l’Est algérien et en 1916 dans les Aurès, l’insurrection était au programme, il n’en allait pas de même en mai 1945. Cette idée a sans doute agité les esprits, mais aucune preuve n’a pu en être avancée, malgré certaines allégations.
La défaite de la France en juin 1940 a modifié les données du conflit entre la colonisation et les nationalistes algériens. Le monde colonial, qui s’était senti menacé par le Front populaire – lequel avait pourtant, sous sa pression, renoncé à ses projets sur l’Algérie –, accueille avec enthousiasme le pétainisme, et avec lui le sort fait aux juifs, aux francs-maçons et aux communistes.
Avec le débarquement américain, le climat se modifie. Les nationalistes prennent au mot l’idéologie anticolonialiste de la Charte de l’Atlantique (12 août 1942) et s’efforcent de dépasser leurs divergences. Le courant assimilationniste se désagrège. Aux partisans d’un soutien inconditionnel à l’effort de guerre allié, rassemblés autour du Parti communiste algérien et des « Amis de la démocratie », s’opposent tous ceux qui, tel le chef charismatique du Parti du peuple algérien (PPA), Messali Hadj, ne sont pas prêts à sacrifier les intérêts de l’Algérie colonisée sur l’autel de la lutte antifasciste.
Vient se joindre à eux un des représentants les plus prestigieux de la scène politique : Ferhat Abbas. L’homme qui, en 1936, considérait la patrie algérienne comme un mythe se prononce pour « une République autonome fédérée à une République française rénovée, anticoloniale et anti-impérialiste », tout en affirmant ne rien renier de sa culture française et occidentale. Avant d’en arriver là, Ferhat Abbas avait envoyé aux autorités françaises, depuis l’accession au pouvoir de Pétain, des mémorandums qui restèrent sans réponse. En désespoir de cause, il transmet aux Américains un texte signé par 28 élus et conseillers financiers, qui devient le 10 février 1943, avec le soutien du PPA et des oulémas, le Manifeste du peuple algérien.
Alors, l’histoire s’accélère. Les gouvernants français continuent à se méprendre sur leur capacité à maîtriser l’évolution. De Gaulle n’a pas compris l’authenticité des poussées nationalistes dans les colonies. Contrairement à ce qui a été dit, son discours de Brazzaville, le 30 janvier 1944, n’annonce aucune politique d’émancipation, d’autonomie (même interne). « Cette incompréhension se manifeste au grand jour avec l’ordonnance du 7 mars 1944 qui, reprenant le projet Blum-Violette de 1936, accorde la citoyenneté française à 65 000 personnes environ et porte à deux cinquièmes la proportion des Algériens dans les assemblées locales », écrit Pierre Mendès France à André Nouschi [2]. Trop peu et trop tard : ces miniréformes ne touchent ni à la domination française ni à la prépondérance des colons, et l’on reste toujours dans une logique où c’est la France qui accorde des droits...
L’ouverture de vraies discussions avec les nationalistes s’imposait. Mais Paris ne les considère pas comme des interlocuteurs. Leur riposte à l’ordonnance du 7 mars intervient le 14 : à la suite d’échanges de vues entre Messali Hadj pour les indépendantistes du PPA, Cheikh Bachir El Ibrahimi pour les oulémas et Ferhat Abbas pour les autonomistes, l’unité des nationalistes se réalise au sein d’un nouveau mouvement, les Amis du Manifeste et de la liberté (AML). Le PPA s’y intègre en gardant son autonomie. Plus rompus aux techniques de la politique moderne et à l’instrumentalisation de l’imaginaire islamique, ses militants orientent leur action vers une délégitimation du pouvoir colonial. La jeunesse urbaine leur emboîte le pas. Partout, les signes de désobéissance se multiplient. Les antagonismes se durcissent. La colonie européenne et les juifs autochtones prennent peur et s’agitent.
Au mois de mai 1945, lors du congrès des AML, les élites plébéiennes du PPA affirmeront leur suprématie. Le programme initial convenu entre les chefs de file du nationalisme – la revendication d’un Etat autonome fédéré à la France – sera rangé au magasin des accessoires. La majorité optera pour un Etat séparé de la France et uni aux autres pays du Maghreb et proclamera Messali Hadj « leader incontesté du peuple algérien ». L’administration s’affolera et fera pression sur Ferhat Abbas pour qu’il se dissocie de ses partenaires.
Cette confrontation s’était préparée dès avril. Les dirigeants du PPA – et plus précisément les activistes, avec à leur tête le Dr Mohamed Lamine Debaghine – sont séduits par la perspective d’une insurrection, espérant que le réveil du millénarisme et l’appel au djihad favoriseront le succès de leur entreprise. Mais leur projet irréaliste avorte. Dans le camp colonial, où l’on craint de voir les Algériens rejeter les « Européens » à la mer, le complot mis au point par la haute administration, à l’instigation de Pierre-René Gazagne, haut fonctionnaire du Gouvernement général, pour décapiter les AML et le PPA prend jour après jour de la consistance.
L’enlèvement de Messali Hadj et sa déportation à Brazzaville, le 25 avril 1945, après les incidents de Reibell, où il est assigné à résidence, préparent l’incendie. La crainte d’une intervention américaine à la faveur de démonstrations de force nationalistes hantait certains, dont l’islamologue Augustin Berque [3]. Exaspéré par le coup de force contre son leader, le PPA fait de la libération de Messali Hadj un objectif majeur et décide de défiler à part le 1er mai, avec ses propres mots d’ordre, ceux de la CGT et des PC français et algérien restant muets sur la question nationale. A Oran et à Alger, la police et des Européens tirent sur le cortège nationaliste. Il y a des morts, des blessés, de nombreuses arrestations, mais la mobilisation continue.
Le 8 mai, le Nord constantinois, délimité par les villes de Bougie, Sétif, Bône et Souk-Ahras et quadrillé par l’armée, s’apprête, à l’appel des AML et du PPA, à célébrer la victoire des alliés. Les consignes sont claires : rappeler à la France et à ses alliés les revendications nationalistes, et ce par des manifestations pacifiques. Aucun ordre n’avait été donné en vue d’une insurrection. On ne comprendrait pas sans cela la limitation des événements aux régions de Sétif et de Guelma. Dès lors, pourquoi les émeutes et pourquoi les massacres ?
La guerre a indéniablement suscité des espoirs dans le renversement de l’ordre colonial. L’évolution internationale les conforte. Les nationalistes, PPA en tête, cherchent à précipiter les événements. De la dénonciation de la misère et de la corruption à la défense de l’islam, tout est mis en œuvre pour mobiliser. « Le seul môle commun à toutes les couches sociales reste [...] le djihad, compris comme arme de guerre civile plus que religieuse. Ce cri provoque une terreur sacrée qui se mue en énergie guerrière », écrit l’historienne Annie Rey-Goldzeiguer [4]. La maturité politique n’était pas au rendez-vous chez les ruraux, qui ne suivaient que leurs impulsions.
Chez les Européens, une peur réelle succède à l’angoisse diffuse. Malgré les changements, l’égalité avec les Algériens leur reste insupportable. Il leur faut coûte que coûte écarter cette alternative. Même la pâle menace de l’ordonnance du 7 mars 1944 les effraie. Leur seule réponse, c’est l’appel à la constitution de milices et à la répression. Ils trouvent une écoute chez Pierre-René Gazagne, chez le préfet de Constantine Lestrade Carbonnel et le sous-préfet de Guelma André Achiary, qui s’assignent pour but de « crever l’abcès ».
A Sétif, la violence commence lorsque les policiers veulent se saisir du drapeau du PPA, devenu depuis le drapeau algérien, et des banderoles réclamant la libération de Messali Hadj et l’indépendance. Elle s’étend au monde rural, où l’on assiste à une levée en masse des tribus. A Guelma, les arrestations et l’action des milices déclenchent les événements, incitant à la vengeance contre les colons des environs. Les civils européens et la police se livrent à des exécutions massives et à des représailles collectives. Pour empêcher toute enquête, ils rouvrent les charniers et incinèrent les cadavres dans les fours à chaux d’Héliopolis. Quant à l’armée, son action a fait dire à un spécialiste, Jean-Charles Jauffret, que son intervention « se rapproche plus des opérations de guerre en Europe que des guerres coloniales traditionnelles » [5]. Dans la région de Bougie, 15 000 femmes et enfants doivent s’agenouiller avant d’assister à une prise d’armes.
Le bilan des « événements » prête d’autant plus à contestation que le gouvernement français a mis un terme à la commission d’enquête présidée par le général Tubert et accordé l’impunité aux tueurs. Si on connaît le chiffre des victimes européennes, celui des victimes algériennes recèle bien des zones d’ombre. Les historiens algériens [6] continuent légitimement à polémiquer sur leur nombre. Les données fournies par les autorités françaises n’entraînent pas l’adhésion. En attendant des recherches impartiales [7], convenons avec Annie Rey-Goldzeiguer que, pour les 102 morts européens, il y eut des milliers de morts algériens.
Les conséquences du séisme sont multiples. Le compromis tant recherché entre le peuple algérien et la colonie européenne apparaît désormais comme un vœu pieux.
En France, les forces politiques issues de la Résistance se laissent investir par le parti colonial. « Je vous ai donné la paix pour dix ans ; si la France ne fait rien, tout recommencera en pire et probablement de façon irrémédiable », avait averti le général Duval, maître d’œuvre de la répression.
Le PCF – qui a qualifié les chefs nationalistes de « provocateurs à gages hitlériens » et demandé que « les meneurs soient passés par les armes » – sera, malgré son revirement ultérieur et sa lutte pour l’amnistie, considéré comme favorable à la colonisation. En Algérie, après la dissolution des AML le 14 mai, les autonomistes et les oulémas accusent le PPA d’avoir joué les apprentis sorciers et mettent fin à l’union du camp nationaliste. Les activistes du PPA imposent à leurs dirigeants la création d’une organisation paramilitaire à l’échelle nationale. Le 1er novembre 1954, on les retrouvera à la tête d’un Front de libération nationale. La guerre d’Algérie a bel et bien commencé à Sétif le 8 mai 1945.
Afin,d'enrichir le contenu de document envoyer un message à l'email suivant: Envoyer un message
Merci d'avance.
Mohamed Harbi : "les violences de la guerre d’indépendance algérienne"
Les dégâts de la griserie de la violence:
Le recours à la violence lors de la guerre d’indépendance algérienne peut-il être qualifié de « terrorisme » ? La situation de l’Algérie était complètement bloquée. Aucune évolution ne s’était produite depuis 1920. Les manifestations des nationalistes du MTLD [3] étaient réprimées en Algérie comme en France, entraînant des morts d’hommes, aussi bien en mai 1945 à Sétif qu’à Paris les 14 juillet 1953 et 1er mai 1954. Le passage à la lutte armée devenait inévitable. Plutôt que de parler de « guerre juste », je dirai plutôt que c’était une guerre nécessaire, inévitable. Il ne faut pas englober ce type de résistance légitime dans un concept flou et stigmatisant de « terrorisme ».
On peut toutefois constater que le mouvement anti-colonial en Algérie - contrairement à la Chine ou au Vietnam où cela a été fait avant de la déclencher - a fait preuve d’une incapacité à penser politiquement les objectifs et les méthodes de la guerre révolutionnaire. Si beaucoup de militants nationalistes avaient compris, notamment en faisant le bilan de l’insurrection du 8 mai 1945 (de son déroulement - des Européens proches des nationalistes algériens avaient figuré parmi les victimes assassinées et mutilées… - comme de la répression qui l’avait suivie), qu’une insurrection armée devait être soigneusement organisée pour éviter qu’elle soit à nouveau marquée par des violences incontrôlées et ne provoque une répression massive, le FLN n’a pas su l’encadrer et l’organiser. Ses dirigeants ont fait preuve de suivisme par rapport au contexte, ont eu tendance à répondre aux événements au coup par coup, sans trop savoir où ils allaient , en généralisant simplement ce qui leur apparaissait, à court terme, comme le plus efficace. Ils n’ont pas su imposer une direction. Ils ont été sans cesse écartelés entre les pratiques incontrôlées d’une base rurale qu’ils ne voulaient pas heurter de front et des bribes de réflexion politique.
Dès le 1er novembre 1954, l’assassinat de l’instituteur Monnerot était en contradiction avec les consignes données qui disaient clairement de ne pas s’attaquer aux civils européens (ce qu’ont d’ailleurs reconnu les services de renseignement français, en particulier le colonel Schoen du Service des liaisons nord-africaines, qui l’ont analysé comme une bavure). Mais ces consignes n’étaient ni comprises ni appliquées à la base, dans les campagnes. La guerre de libération y était perçue comme une guerre « race contre race » et elle conduisait à des violences non seulement contre les civils européens mais - beaucoup plus nombreuses - contre les Algériens qui n’étaient pas acquis au FLN. Les dirigeants tenaient compte de cet état d’esprit de la base, tout en freinant, souvent, les violences contre les civils.
Les choses auraient pu se dérouler autrement s’il n’y avait pas eu la scission du MTLD, et si le FLN avait réussi à se donner une direction politique. C’est ce qu’a tenté Ramdane Abbane lors du congrès de la Soummam en 1956. Il y a critiqué la violence incontrôlée qui s’était manifestée un an plus tôt, lors de la journée du 20 août 1955. C’est d’ailleurs l’une des raisons de l’hostilité qu’il a suscitée de la part de chefs de maquis et de son assassinat par eux, peu après. Ceux qui partageaient le point de vue d’Abbane, comme Ben Khedda, étaient l’objet d’une terrible pression de la base paysanne du FLN et ont été vite marginalisés au profit de l’idée d’organiser des attentats dans les villes. Mais, paradoxalement, on a vu ceux-là mêmes qui, dans les villes, avaient commis des attentats contre des civils, comme ceux du Milk Bar et du Casino de la Corniche à Alger en 1957, s’interroger sur ces actions, y compris le chef de la Zone autonome d’Alger Yacef Saadi, qui n’était pourtant pas un politique mais un activiste, mais qui, après avoir rencontré Germaine Tillon, s’est rallié à l’idée de ne s’attaquer qu’aux biens et pas aux personnes.
La question de l’opportunité des attentats a fait débat au sein du FLN. Lorsque la possibilité d’actes terroristes en France a été évoquée, notamment en 1957 et en 1961, non seulement les principaux dirigeants s’y sont opposés [4], mais des cadres de la Fédération de France, qui s’en tenaient à la position traditionnelle du mouvement national algérien d’avant la scission du MTLD, consistant à limiter l’action en France à une action politique, y ont été hostiles eux aussi. Quant à l’hypothèse de répliquer par des attentats dans des pays tiers, examinée au moment où les services français avaient assassiné certains de nos cadres en Belgique et en Allemagne dans des attentats que l’on peut qualifier de terroristes, elle a été écartée catégoriquement.
Chez Frantz Fanon [5], il y a une sorte d’éloge de la violence « purificatrice », qui conduit à frapper et rejeter les Européens. Était-ce l’avis de tous les dirigeants du FLN ? Nous étions nombreux dans le FLN, à ne pas faire, à l’image de Fanon, de la violence un absolu, notamment parmi ceux qui avaient prôné la lutte armée pour sortir la question algérienne de l’impasse, Aït Ahmed, entre autres. J’ai évoqué personnellement ce sujet dans un numéro des Temps modernes consacré à Sartre [6], dont la préface aux Damnés de la Terre a donné un grand retentissement aux thèses de Fanon. Nos interrogations et objections n’ont pas été prises en compte par l’appareil du FLN. Pour revenir à Fanon, je pense qu’en raison des conditions propres au tiers-monde, il avait raison de souligner les limites politiques de la classe ouvrière, mais en mettant l’accent comme le pensait dans les années 1940 déjà le commandant Oussedik, son ami intime, sur la relève par la paysannerie, il a occulté la prééminence des couches bureaucratiques dans la direction du mouvement. Certains militants qui avaient été proches des communistes ou de la gauche française y ajoutaient leur déception devant les syndicats et les partis se réclamant de la classe ouvrière. Il faut dire qu’en face, ni les autorités françaises ni les Européens d’Algérie qui avaient pourtant le contrôle des villes, n’ont choisi le dialogue politique qui aurait pu conduire à une autre solution, du type de celle qu’a connu depuis l’Afrique du Sud. Ils ont fait, eux aussi, le choix, au contraire, de la guerre contre la population et du terrorisme, donnant des arguments au courant le plus activiste au sein du FLN.
Reste que la violence contre les civils européens a contribué à rendre impossible le maintien des Européens dans l’Algérie indépendante ? Les initiateurs de l’insurrection de 1954 n’envisageaient pas un instant le départ massif des Européens. Mais - j’ai pu le constater - les combattants des maquis, ceux de l’armée des frontières, souvent originaires des régions montagneuses, ne pensaient pas, eux, qu’il puisse y avoir une Algérie indépendante pluriethnique. Chez certains dirigeants, comme Ben Tobbal [7], la méfiance et la peur de la concurrence des Européens les conduisaient au même rejet. Mais cette tendance n’aurait peut-être pas prévalu si les gouvernements français n’avaient pas eu comme seule réponse d’étendre la guerre et si le terrorisme de l’OAS ne s’était pas imposé chez les Européens d’Algérie. L’évolution des événements a contredit la vision politique d’hommes comme Saad Dahlab [8] qui n’ont pas trouvé à leur goût l’issue de la guerre et l’exode des Pieds-Noirs. Si le FLN a manqué d’une vision claire de la guerre, en face, les gouvernements français et les Européens d’Algérie ont été, eux aussi, dans une position uniquement réactive, sans aucune vision de leurs objectifs, dans une sorte d’inconscience et d’aveuglement.
La violence contre les Algériens a permis, à court terme, de renforcer l’influence du FLN, mais n’est-elle pas aussi à l’origine des problèmes qu’a connus l’Algérie après l’indépendance ? Les méthodes du FLN pour obtenir le ralliement des Algériens (menaces de mort contre ceux qui ne cotiseraient pas, etc.) se sont avérées très efficaces ; elles ont même provoqué une sorte de griserie chez ceux qui y recouraient. Même ceux qui, au début, acceptaient de s’interroger sur les objectifs et les méthodes utilisées, ont fini par ne même plus écouter les objections aux actions violentes mises en œuvre. Mais ce n’est pas seulement sur le court terme, c’est sur la durée que l’on juge des conséquences de cette orientation. Or, sur la durée, cette violence a eu des conséquences dramatiques sur le tissu social algérien, provoquant - conjointement avec la violence coloniale - la destruction du vieil encadrement rural, d’une bonne partie des couches urbaines cultivées et de l’encadrement syndical et politique.
Cette idée que la violence avait un effet « miraculeux » et l’absence de réflexion sur les formes et modalités légitimes de la violence est directement à l’origine de ce que l’Algérie a vécu depuis. L’idée que la violence est une solution miracle, qu’il suffit d’un souffle messianique pour vaincre, s’est répandue avec les conséquences dramatiques que l’on sait. Après le FLN, les islamistes s’y sont enfermés à nouveau. Eux qui, en 1988-1992, représentaient le mouvement populaire le plus profond que l’Algérie ait connu depuis le MTLD, ont été incapables de se fixer des objectifs politiques, de se donner une direction, de contenir les courants activistes, qui les ont amenés à la ruine. Ils ont repris en l’aggravant le messianisme qui était l’un des défauts de la guerre de libération. Un autre défaut de cette lutte a été la propension à l’exacerbation des conflits entre Algériens. Déjà avant 1954, nous autres militants du MTLD avions pour consigne d’interdire la tenue des réunions de nos concurrents de l’UDMA [9]. La scission du MTLD a débouché ensuite sur une guerre terrible où ont péri de nombreux cadres du mouvement national. Loin de voir les oulémas ou les élus réformistes comme des alliés possibles, nous les voyions comme des ennemis. Et le moindre conflit interne au mouvement national tendait à déboucher sur des anathèmes et des exclusions.
S’il y a une leçon à tirer de la guerre de libération algérienne, c’est que le terrorisme contre les civils dessert les luttes des opprimés et des exclus, désarme et désoriente les forces qui, en Europe et aux États-Unis, s’identifient à leur cause. Si, par delà les appartenances différentes, on veut que les droits humains et la démocratie soient accessibles à tous, il faut commencer par prendre ses distances à l’égard de toute rétraction identitaire. Il n’est pas d’autre voie pour surmonter la politique des deux poids, deux mesures que les dirigeants américains mettent en œuvre au Moyen-Orient ou ailleurs. Ne leur donnons pas l’occasion d’entraîner leur peuple à leur côté. Dans cet ordre d’idées, la voie prônée par un Ben Laden mène à la défaite, quand ce n’est pas à la tragédie. Nous le vérifions tous les jours.
article de la rubrique les deux rives de la Méditerranée > la guerre d’Algérie date de publication : février 2002
Le général Paul Aussaresses a été condamné, vendredi 25 janvier 2002, à 7 500 € d’amende par la 17e chambre correctionnelle de Paris, pour "apologie de crimes de guerre", après la publication, le 3 mai 2001, de son ouvrage, Services spéciaux, Algérie, 1955-1957. Les éditeurs du général, Olivier Orban, le PDG de Plon, et Xavier de Bartillat, celui de Perrin, ont été condamnés à 15 000 € d’amende chacun. Voir en ligne : la condamnation du général Aussaresses est maintenant définitive (décembre 2004) Communiqué de la LDH Paris, le 25 janvier 2002, La LDH se félicite d’un jugement qui reconnaît l’existence de crimes de guerre commis par des militaires durant la guerre d’Algérie. Ce jugement porte aussi condamnation de tous ceux qui considèrent que la torture, les exécutions sommaires et les enlèvements seraient admissibles dans certaines circonstances. Mais cette décision ne rend pas compte, et ne pouvait rendre compte, de tous les errements qu’a connus cette guerre coloniale faite à un peuple qui réclamait sa liberté. Sans doute, les victimes ne trouveront pas dans cette décision la reconnaissance à laquelle elles ont droit. La LDH espère que cette décision sera un des premiers pas en direction de la vérité et de la reconnaissance des responsabilités de tous ceux qui ont mené cette sale guerre. Les motivations du jugement sont sévères. Après avoir écarté les problèmes de forme, le tribunal, présidé par Catherine Bezio, s’est longuement penché sur l’apologie des crimes de guerre. Un délit de presse, puisque les crimes d’Algérie sont, en l’état actuel du droit français, amnistiés et prescrits. Pour le tribunal, l’apologie du crime de guerre consiste à le présenter "de telle sorte que le lecteur est incité à porter sur ce crime un jugement de valeur favorable, effaçant la réprobation morale qui, de par la loi, s’attache à ce crime". Que la torture et les exécutions sommaires soient prescrites ou amnistiées importe peu, le délit d’apologie, insiste les juges, "pouvant avoir trait à des crimes réels, passés, ou simplement éventuels". Ci-dessous des extraits du jugement : A deux reprises, dès le début de son récit, Paul AUSSARESSES vient compléter cette présentation de la torture, ainsi qualifiée d’inéluctable, par un commentaire personnel légitimant cette pratique. Ces passages, visés par la citation (p.30 et 31 - p.44 et 45) décrivent, l’un, l’initiation de Paul AUSSARESSES à la torture par les policiers de PHILIPEVILLE, l’autre, la scène où, pour la première fois, le prévenu, lui-même, torture un prisonnier : Pages 30 et 31 « Les policiers de Philippeville utilisaient donc la torture, comme tous les policiers d’Algérie, et leur hiérarchie le savait. Ces policiers n’étaient ni des bourreaux ni des monstres mais des hommes ordinaires. Des gens dévoués à leur pays, profondément pénétrés du sens du devoir mais livrés à des circonstances exceptionnelles. Je ne tardai du reste pas à me convaincre que ces circonstances expliquaient et justifiaient leurs méthodes. Car pour surprenante qu’elle fût, l’utilisation de cette forme de violence, inacceptable en des temps ordinaires, pouvait devenir inévitable dans une situation qui dépassait les bornes. Les policiers se tenaient à un principe : quand il fallait interroger un homme, qui, même au nom d’un idéal, avait répandu le sang d’un innocent, la torture devenait légitime. » Pages 44 et 45 « ... Je n’ai pas eu de haine ni de pitié. Il y avait urgence et j’avais sous la main un homme directement impliqué dans un acte terroriste : tous les moyens étaient bons pour le faire parler. C’était les circonstances qui voulaient ça. » Placés en tête de récit, ces propos exposent une réflexion générale de l’auteur sur la torture [...] Les deux passages en cause justifient, de la même manière, la commission des actes de torture ainsi décrits, dans la mesure où ceux-ci sont présentés non seulement comme inévitables (p.30 « inacceptable en temps ordinaires, [cette forme de violence] pouvait devenir inévitable » - p.44 : « j’ai été conduit à user de moyens contraignants ») mais aussi comme légitimes (p.31 « la torture devenait légitime dans les cas où l’urgence l’imposait » - p.45 : « il y avait urgence[...] tous les moyens étaient bons pour le faire parler. C’était les circonstances qui voulaient ça »). En dépit des prétentions contraires de Paul AUSSARESSES, cette véritable pétition de principe, posée en exergue de son ouvrage, qui légitime expressément l’usage de la torture et toutes autres exactions permettant l’élimination physique immédiate de l’adversaire, valorise, par avance, l’ensemble des actes perpétrés et décrits dans les pages suivantes du livre ; elle a ainsi, pour effet d’ôter, aux yeux du lecteur, la réprobation morale inhérente à ces actes, - condamnés sans réserve par la communauté internationale dans les textes rappelés ci-dessus. L’apologie, pour le tribunal, est caractérisée. Non parce que le général n’a pas de regrets, ce qui "ne relève que du domaine de la morale et de la conscience", mais parce que la torture, "qualifiée d’inéluctable", est accompagnée "par un commentaire personnel légitimant cette pratique". Paul Aussaresses est par ailleurs "l’acteur d’un passé qu’il ne s’agit plus de juger", mais "ces actes et ces pratiques, bien que hors-la-loi, apparaissent avoir été connus et tolérés par les plus hautes autorités militaires et politiques de l’Etat français, de surcroît jamais sanctionnés, et amnistiés depuis plus de trente ans". ________________________________________ Voici les comptes-rendus des audience parus dans Le Monde. LA TORTURE AU COEUR DES DÉBATS [Le Monde, 28 novembre 2001] Le "calvaire" des victimes de la torture, mais aussi celui des soldats "obligés" par leur hiérarchie à torturer pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) ont été évoqués, mardi 27 novembre, au procès du général français Paul Aussaresses pour "complicité d’apologie de crimes de guerre". Simone de Bollardière Au deuxième jour du procès de Paul Aussaresses, la veuve du général Jacques de Bollardière, l’un des rares officiers français à avoir dénoncé la torture pendant cette guerre, a raconté "le calvaire" des soldats français "obligés" par leur hiérarchie à pratiquer ces exactions. Tremblante et visiblement émue, Simone de La Bollardière a affirmé qu’ "aujourd’hui encore, ils n’en parlent pas parce qu’ils sont démolis. Il y a un abcès à l’intérieur d’eux, ils n’ont jamais vu de psychologue". Elle a ensuite accusé Paul Aussaresses, 83 ans, qui a servi sous les ordres de son mari pendant la guerre d’Indochine (1946-1954), de "se vanter" d’avoir pratiqué la torture, ce que ce dernier a aussitôt nié. Henri Alleg, 80 ans, journaliste et militant communiste arrêté et torturé par les parachutistes durant le conflit, a également été entendu à la demande des parties civiles. Pudique sur le sort qu’il a subi durant un mois dans une villa de la région d’Alger - "électricité, étouffement sous l’eau, coups" -, il a évoqué "les cris" des Algériens qui subissaient le même sort. "C’est ce souvenir, encore plus qu’un autre, qui est resté dans ma mémoire", a-t-il dit. Pédagogue, auteur du célèbre ouvrage La Question, l’un des premiers témoignages sur ces sévices, publié en 1958, M. Alleg a aussi indiqué que la torture était une pratique "institutionnalisée" par l’armée française. RETOUR SUR L’AFFAIRE AUDIN Riss - Charlie Hebdo - 5 déc. 2001 M. Alleg et Mme de Bollardière ont encore demandé au général Aussaresses ce qu’il était advenu de Maurice Audin, membre du Parti communiste algérien, disparu depuis 1957, après avoir été arrêté le 11 juin de cette même année à Alger parce que suspecté d’aider le FLN. "Je ne sais pas ce qu’est devenu Maurice Audin", a répété le général Aussaresses, sans convaincre. Aucune explication officielle n’est donnée sur la disparition de ce père de trois enfants, si ce n’est "son évasion au cours d’un transfert". Selon le quotidien communiste L’Humanité, Maurice Audin est mort le 21 juin 1957, "à la villa El Biar à Alger, entre les mains d’un tortionnaire, un lieutenant parachutiste de l’armée française, qui l’avait étranglé". "Le tortionnaire a même été fait commandeur de la Légion d’honneur", affirmait le journal le 4 décembre 1997. A l’époque des faits, Paul Aussaresses était responsable des renseignements français à Alger, sous les ordres de Jacques Massu. LE GÉNÉRAL SCHMITT A JUSTIFIÉ L’USAGE DE LA TORTURE EN ALGÉRIE par Franck Johannès [Le Monde, le 29 novembre 2001] Plusieurs témoins sont venus, mardi 27 novembre, défendre l’honneur de Paul Aussaresses. Le général Maurice Schmitt a justifié l’usage de la torture en Algérie au nom de "la légitime défense d’une population en danger de mort". Henri Alleg a, lui, évoqué l’horreur des sévices qu’il a subis après son arrestation, en 1957. Un quarteron de généraux en retraite bat la semelle devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Ils ont une apparence : courbés, chenus, décorés, à moitié sourds, plein de souvenirs et d’arthrite. Mais, en réalité, ils sont prêts comme au premier jour à défendre l’honneur de la patrie, et de leur camarade Paul Aussaresses, poursuivi pour "complicité d’apologie de crimes de guerre" après son livre sur l’Algérie. Au deuxième jour du procès, mardi 27 novembre, chacun est venu donner son grain de sel, y compris un copain restaurateur qui connaît bien le général Aussaresses depuis deux ans. Et la torture, qu’on croyait crime de guerre, est désormais une opinion : le général Schmitt, par exemple, est plutôt pour, dans les cas exceptionnels naturellement. Henri Alleg est, lui, plutôt contre, d’autant qu’il y est passé, et certains de ses amis en sont morts. C’est un petit homme à l’œil vif, de quatre-vingts ans sonnés, qui était directeur d’Alger républicain , un journal vite interdit. Il a été arrêté en juin 1957 chez Maurice Audin, dont on n’a jamais retrouvé le corps, et a été torturé "à l’électricité, par noyade ou plutôt étouffement sous l’eau, avec des torches de papier". Personne n’ose lui demander d’expliquer. "J’entendais hurler, j’entendais les cris des hommes et des femmes pendant des nuits entières, c’est cela qui est resté dans ma mémoire", a raconté le vieux monsieur, resté un mois dans un "centre de tri". Il a passé trois ans en prison, a fait sortir feuille à feuille son livre, La Question, avant d’être condamné à huis clos à dix ans de prison pour "atteinte à la sûreté de l’État. Et association de malfaiteurs, ça me fait toujours rire, mais c’est comme ça". La guerre d’Algérie, "que l’on présentait comme un combat pour notre civilisation, c’était en fait une guerre contre l’indépendance d’un peuple, menée avec les méthodes des occupants nazis". Henri Alleg a expliqué que Larbi Ben M’Hidi, tué par Paul Aussaresses, était le Jean Moulin algérien. "Si un général allemand comparaissait aujourd’hui pour dire comment il avait suicidé Jean Moulin, tout le monde se demanderait pourquoi on le juge seulement pour apologie de meurtres alors qu’il en a commis tellement." Et il a mis en garde les jeunes contre le retour de la torture, "un retour à la barbarie, au nom de la civilisation ou de la lutte contre la barbarie" . Le vieux monsieur a été digne, profond, touchant. Mais il a été communiste, et la salle, assez largement acquise au général Aussaresses, en a frissonné d’indignation. Me Gilbert Collard, pour Paul Aussaresses, a enfoncé le clou en expliquant qu’en 1962 Henri Alleg collaborait à la Pravda : courte manœuvre, tombée à plat, d’autant qu’il avait seulement donné une interview. "PERDRE MON ÂME" Le général Schmitt témoigne au procès Aussaresses, le 27 nov. 2001 © Riss - Charlie Hebdo - 5 déc. 2001 Après un défilé, assez uniforme, des compagnons de Paul Aussaresses à travers les âges, l’autre témoin majeur est venu déposer. Le général Maurice Schmitt, soixante et onze ans, est un calibre : saint-cyrien, prisonnier à Dien Bien Phu, lieutenant au troisième régiment de parachutistes coloniaux à Alger en 1957, il a aussi été chef d’état-major des armées de 1987 à 1991, c’est-à-dire le plus haut responsable militaire de son temps. Et le général ne tourne pas autour du pot : "Les membres du FLN, avant d’être des terroristes, étaient des tortionnaires." Il suggère assez rudement que Louisette Ighilahriz, violée et torturée, a menti et que "tout ceci est une affaire montée". S’il "n’est pas contestable" qu’il y a eu de la torture en Algérie, c’était "de la légitime défense d’une population en danger de mort". Le général Schmitt est d’ailleurs prêt à recommencer : "S’il faut se salir les mains ou accepter la mort d’innocents, a énoncé le militaire, je choisis de me salir les mains au risque de perdre mon âme." D’ailleurs, "si Moulaï Ali -le responsable d’un réseau de poseurs de bombes- n’avait pas parlé, je l’aurais fait parler. Il y a des cas limites ou vous avez le choix entre la mort d’une centaine d’innocents et un coupable avéré". Maurice Schmitt est lui-même accusé d’avoir torturé la jeune Malika Koriche (Le Monde du 29 juin), mais la question lui a été à peine posée et n’intéresse guère le tribunal. Pourtant, a relevé Me Henri Leclerc pour la Ligue des droits de l’homme, le général Massu lui-même s’est interrogé sur la nécessité de la torture. "Massu aurait dû se poser la question quand il était à la tête de la dixième division parachutiste", a répondu rudement le général. La substitut a réclamé 100 000 francs d’amende pour chacun des prévenus, le général Aussaresses et ses éditeurs. Le jugement sera prononcé le 25 janvier. RSS 2.0 | plan d'ensemble du site | le site national de la LDH | SPIP | squelette Un demi-siècle après l’entrée des parachutistes dans Alger, le 7 janvier 1957, l’historien Benjamin Stora revient sur cette période dans L’Express du 5 janvier 2007 [1]. Voir en ligne : cinquante ans après la bataille d’Alger, le retour de la torture Il y a cinquante ans s’engageait la bataille d’Alger. Comment débutent les opérations ? Le 7 janvier, 8 000 parachutistes entrent dans la ville. Ils sont commandés par le général Massu, à qui Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, vient de confier les pleins pouvoirs. La 10e DP [division parachutiste], tout juste de retour de Suez, où elle a participé à l’opération avortée contre Nasser, reçoit la mission de "pacifier" Alger, où la tension est extrême entre les communautés. Lacoste peut remplacer la police et la justice par des militaires ? Il utilise pour cela la loi sur les pouvoirs spéciaux votée en mars 1956 à l’initiative du gouvernement dirigé par Guy Mollet (SFIO). Le texte avait été adopté par l’ensemble des partis, dont le PC, à l’exception des poujadistes. Ce sont donc les Français qui décident de la bataille d’Alger ? Les deux camps cherchent à en finir. Les militaires français veulent porter un coup décisif aux indépendantistes algériens. Les négociations secrètes qui se déroulaient à Belgrade ou à Rome durant l’été 1956 ont été rompues et, du coup, le gouvernement de Guy Mollet cherche le bras de fer. De leur côté, les dirigeants du FLN avaient décidé de concentrer les opérations sur Alger lors du congrès de 1956, qui s’était tenu dans la vallée de la Soummam, en Kabylie. Pourquoi ? Ils savent que le "bruit" à Alger peut avoir un impact considérable. Les dirigeants du FLN constatent que la guérilla dans le djebel n’intéresse que peu les médias et l’opinion publique, en particulier l’opinion publique internationale, alors que la question algérienne est pourtant débattue à l’ONU. Mais ils ne mesurent pas, je crois, la violence de la réponse que va leur opposer l’Etat français. Ils pensaient pouvoir infliger une défaite à un pouvoir jugé affaibli. Comment le FLN réagit-il à l’arrivée des parachutistes ? La réplique à l’entrée de l’armée dans la ville, ce sont les attentats aveugles contre les Européens, causant des dizaines de victimes. Début février, les explosions au stade municipal d’Alger et au stade d’El-Biar font 10 morts et 34 blessés ; en juin, l’attentat au casino de la Corniche tue 8 personnes et en blesse une centaine. Le 26 janvier, des bombes avaient explosé dans trois cafés de la ville, faisant 5 morts et 34 blessés. Le FLN lance alors un mot d’ordre de grève générale pour le 28 janvier... Un soldat français utilise un détecteur de mines sur les passants à Alger le 16 janvier 1957. Que font les paras ? Ils cassent la grève en forçant les boutiques à rouvrir ; l’opération du FLN est un échec. Et puis les hommes de Massu procèdent à des arrestations massives pour débusquer les militants du FLN, qui sont environ 5 000. Massu quadrille la ville avec ses troupes. Les quartiers "arabes" sont bouclés. Et, en utilisant les fichiers de la police, les paras interpellent des suspects par centaines avant de les regrouper dans des centres de triage, qui vont devenir de véritables centres de torture. Le gouvernement couvre ces pratiques ? Oui, les politiques couvrent. Mais, devant les critiques, Guy Mollet va être obligé, en mai 1957, d’installer une "commission de sauvegarde des libertés" dont le rapport ne sera jamais officiellement rendu public. C’est finalement le journal Le Monde qui en fera état, mais en le publiant simultanément avec un bilan chiffré dressé par le gouvernement sur les exactions du FLN. Pourtant, des voix s’élèvent pour dénoncer la torture... Oui, mais ces protestations proviennent pour l’essentiel des journaux, et non pas des partis. La presse se substitue aux organisations politiques. L’Express est d’ailleurs en pointe dans cette bataille. Jean-Jacques Servan-Schreiber publie ses carnets, Lieutenant en Algérie, dans lesquels il dénonce les pratiques de certains militaires. Il reçoit le soutien du général de Bollardière, qui démissionne de ses fonctions. D’autres voix s’élèvent contre la torture, comme celle de l’écrivain catholique Pierre-Henri Simon ou celle du comité Maurice Audin, du nom d’un jeune mathématicien enlevé par les paras. Ce mouvement, animé par Laurent Schwartz et Pierre Vidal-Naquet, réclame la vérité sur cette disparition. Comment réagit l’opinion publique ? Le problème de la torture en Algérie avait été évoqué depuis déjà deux années. En 1955, dans L’Express, François Mauriac avait publié un article sur la question. Mais c’est avec la bataille d’Alger que le débat va réellement toucher l’opinion publique. Les syndicats, les Eglises, les familles vont se diviser. Et le clivage entre ceux qui comprennent le recours à la torture et ceux qui pensent que la France y perd son honneur va dépasser les habituelles frontières politiques. Des catholiques de droite vont, par exemple, prendre des positions communes avec des militants de gauche, alors que la SFIO et même le PC sont traversés par de graves dissensions. C’est donc une crise majeure de la société française ? Depuis l’affaire Dreyfus, les Français ne s’étaient pas opposés les uns aux autres aussi violemment. Quel est l’impact en Algérie même ? En Algérie, l’affrontement entre les "terroristes" du FLN et les paras va conduire à l’effondrement du courant libéral, porté par exemple par le maire d’Alger, Jacques Chevallier. On assiste à une radicalisation communautaire au détriment de ceux qui recherchaient une solution négociée. Le couple infernal terrorisme-torture fait taire les voix modérées. De cette époque date le silence d’Albert Camus sur le drame algérien. Pour certains, c’est pourtant grâce à la torture que, finalement, les paras ont gagné la bataille d’Alger... A quel prix ! Outre les milliers de "disparitions", l’honneur perdu et l’opprobre jeté sur l’institution militaire, et au bout du compte l’indépendance de l’Algérie, les initiateurs français de la bataille d’Alger ont définitivement miné la IVe République. En confiant les pouvoirs de police et de justice aux paras, Guy Mollet et Robert Lacoste ont accrédité l’idée selon laquelle seuls les militaires pouvaient incarner un recours. On connaît la suite... Et côté algérien ? C’est d’abord une défaite. Les dirigeants du FLN qui ont échappé aux paras ont dû quitter la ville et le pays pour se réfugier en Tunisie. Et les nationalistes n’oseront plus manifester dans les rues d’Alger avant décembre 1960. Mais, paradoxalement, la bataille d’Alger a permis au FLN de conquérir l’hégémonie politique, notamment, en éliminant les militants messalistes [du nom de Messali Hadj, principal leader du Mouvement national algérien]. Pendant que l’attention se porte sur la bataille d’Alger, trois villageois soupçonnés de sympathies messalistes sont, par exemple, assassinés par une unité de l’Armée de libération nationale (ALN), le 28 mai 1957. La France fera-t-elle son examen de conscience ? A partir de 1962, les Français aspirent à tourner la page de la guerre. Il ne faut pas oublier que notre pays était impliqué dans des conflits armés depuis 1939 ! Et puis, avec le début des années 1960, on change de monde pour entrer dans la société de consommation. On ne reparlera donc plus de la torture. D’autant que les lois d’amnistie interdiront toutes les poursuites judiciaires. Le débat sur la torture n’a donc jamais été mené jusqu’au bout ? Non, et même le Parti socialiste, héritier de la SFIO, n’a jamais, sur cette question particulière, tenté un travail significatif de mémoire. Et il est d’ailleurs frappant de constater que les Américains sont, en Irak, confrontés au même problème - pratiquer la torture au nom de l’efficacité « policière » - et paraissent avoir apporté la même réponse que le gouvernement français de l’époque. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le film de Gilles Pontecorvo La Bataille d’Alger, tourné en 1966, a été montré, au Pentagone, en 2003, aux officiers américains avant leur départ pour la guerre en Irak. En ce sens, le parallèle à faire entre hier et aujourd’hui n’est pas avec la guerre du Vietnam mais bien avec la guerre d’Algérie. C’est ce que reconnaissent désormais de nombreux éditorialistes de la presse américaine... Propos recueillis par Laurent Chabrun Paris, le 25 janvier 2002, La LDH se félicite d’un jugement qui reconnaît l’existence de crimes de guerre commis par des militaires durant la guerre d’Algérie. Ce jugement porte aussi condamnation de tous ceux qui considèrent que la torture, les exécutions sommaires et les enlèvements seraient admissibles dans certaines circonstances. Mais cette décision ne rend pas compte, et ne pouvait rendre compte, de tous les errements qu’a connus cette guerre coloniale faite à un peuple qui réclamait sa liberté. Sans doute, les victimes ne trouveront pas dans cette décision la reconnaissance à laquelle elles ont droit. La LDH espère que cette décision sera un des premiers pas en direction de la vérité et de la reconnaissance des responsabilités de tous ceux qui ont mené cette sale guerre. Les motivations du jugement sont sévères. Après avoir écarté les problèmes de forme, le tribunal, présidé par Catherine Bezio, s’est longuement penché sur l’apologie des crimes de guerre. Un délit de presse, puisque les crimes d’Algérie sont, en l’état actuel du droit français, amnistiés et prescrits. Pour le tribunal, l’apologie du crime de guerre consiste à le présenter "de telle sorte que le lecteur est incité à porter sur ce crime un jugement de valeur favorable, effaçant la réprobation morale qui, de par la loi, s’attache à ce crime". Que la torture et les exécutions sommaires soient prescrites ou amnistiées importe peu, le délit d’apologie, insiste les juges, "pouvant avoir trait à des crimes réels, passés, ou simplement éventuels". Ci-dessous des extraits du jugement : A deux reprises, dès le début de son récit, Paul AUSSARESSES vient compléter cette présentation de la torture, ainsi qualifiée d’inéluctable, par un commentaire personnel légitimant cette pratique. Ces passages, visés par la citation (p.30 et 31 - p.44 et 45) décrivent, l’un, l’initiation de Paul AUSSARESSES à la torture par les policiers de PHILIPEVILLE, l’autre, la scène où, pour la première fois, le prévenu, lui-même, torture un prisonnier : Pages 30 et 31 « Les policiers de Philippeville utilisaient donc la torture, comme tous les policiers d’Algérie, et leur hiérarchie le savait. Ces policiers n’étaient ni des bourreaux ni des monstres mais des hommes ordinaires. Des gens dévoués à leur pays, profondément pénétrés du sens du devoir mais livrés à des circonstances exceptionnelles. Je ne tardai du reste pas à me convaincre que ces circonstances expliquaient et justifiaient leurs méthodes. Car pour surprenante qu’elle fût, l’utilisation de cette forme de violence, inacceptable en des temps ordinaires, pouvait devenir inévitable dans une situation qui dépassait les bornes. Les policiers se tenaient à un principe : quand il fallait interroger un homme, qui, même au nom d’un idéal, avait répandu le sang d’un innocent, la torture devenait légitime. » Pages 44 et 45 « ... Je n’ai pas eu de haine ni de pitié. Il y avait urgence et j’avais sous la main un homme directement impliqué dans un acte terroriste : tous les moyens étaient bons pour le faire parler. C’était les circonstances qui voulaient ça. » Placés en tête de récit, ces propos exposent une réflexion générale de l’auteur sur la torture [...] Les deux passages en cause justifient, de la même manière, la commission des actes de torture ainsi décrits, dans la mesure où ceux-ci sont présentés non seulement comme inévitables (p.30 « inacceptable en temps ordinaires, [cette forme de violence] pouvait devenir inévitable » - p.44 : « j’ai été conduit à user de moyens contraignants ») mais aussi comme légitimes (p.31 « la torture devenait légitime dans les cas où l’urgence l’imposait » - p.45 : « il y avait urgence[...] tous les moyens étaient bons pour le faire parler. C’était les circonstances qui voulaient ça »). En dépit des prétentions contraires de Paul AUSSARESSES, cette véritable pétition de principe, posée en exergue de son ouvrage, qui légitime expressément l’usage de la torture et toutes autres exactions permettant l’élimination physique immédiate de l’adversaire, valorise, par avance, l’ensemble des actes perpétrés et décrits dans les pages suivantes du livre ; elle a ainsi, pour effet d’ôter, aux yeux du lecteur, la réprobation morale inhérente à ces actes, - condamnés sans réserve par la communauté internationale dans les textes rappelés ci-dessus. L’apologie, pour le tribunal, est caractérisée. Non parce que le général n’a pas de regrets, ce qui "ne relève que du domaine de la morale et de la conscience", mais parce que la torture, "qualifiée d’inéluctable", est accompagnée "par un commentaire personnel légitimant cette pratique". Paul Aussaresses est par ailleurs "l’acteur d’un passé qu’il ne s’agit plus de juger", mais "ces actes et ces pratiques, bien que hors-la-loi, apparaissent avoir été connus et tolérés par les plus hautes autorités militaires et politiques de l’Etat français, de surcroît jamais sanctionnés, et amnistiés depuis plus de trente ans". ________________________________________ Voici les comptes-rendus des audience parus dans Le Monde. LA TORTURE AU COEUR DES DÉBATS [Le Monde, 28 novembre 2001] Le "calvaire" des victimes de la torture, mais aussi celui des soldats "obligés" par leur hiérarchie à torturer pendant la guerre d’Algérie (1954-1962) ont été évoqués, mardi 27 novembre, au procès du général français Paul Aussaresses pour "complicité d’apologie de crimes de guerre". Simone de Bollardière Au deuxième jour du procès de Paul Aussaresses, la veuve du général Jacques de Bollardière, l’un des rares officiers français à avoir dénoncé la torture pendant cette guerre, a raconté "le calvaire" des soldats français "obligés" par leur hiérarchie à pratiquer ces exactions. Tremblante et visiblement émue, Simone de La Bollardière a affirmé qu’ "aujourd’hui encore, ils n’en parlent pas parce qu’ils sont démolis. Il y a un abcès à l’intérieur d’eux, ils n’ont jamais vu de psychologue". Elle a ensuite accusé Paul Aussaresses, 83 ans, qui a servi sous les ordres de son mari pendant la guerre d’Indochine (1946-1954), de "se vanter" d’avoir pratiqué la torture, ce que ce dernier a aussitôt nié. Henri Alleg, 80 ans, journaliste et militant communiste arrêté et torturé par les parachutistes durant le conflit, a également été entendu à la demande des parties civiles. Pudique sur le sort qu’il a subi durant un mois dans une villa de la région d’Alger - "électricité, étouffement sous l’eau, coups" -, il a évoqué "les cris" des Algériens qui subissaient le même sort. "C’est ce souvenir, encore plus qu’un autre, qui est resté dans ma mémoire", a-t-il dit. Pédagogue, auteur du célèbre ouvrage La Question, l’un des premiers témoignages sur ces sévices, publié en 1958, M. Alleg a aussi indiqué que la torture était une pratique "institutionnalisée" par l’armée française. RETOUR SUR L’AFFAIRE AUDIN Riss - Charlie Hebdo - 5 déc. 2001 M. Alleg et Mme de Bollardière ont encore demandé au général Aussaresses ce qu’il était advenu de Maurice Audin, membre du Parti communiste algérien, disparu depuis 1957, après avoir été arrêté le 11 juin de cette même année à Alger parce que suspecté d’aider le FLN. "Je ne sais pas ce qu’est devenu Maurice Audin", a répété le général Aussaresses, sans convaincre. Aucune explication officielle n’est donnée sur la disparition de ce père de trois enfants, si ce n’est "son évasion au cours d’un transfert". Selon le quotidien communiste L’Humanité, Maurice Audin est mort le 21 juin 1957, "à la villa El Biar à Alger, entre les mains d’un tortionnaire, un lieutenant parachutiste de l’armée française, qui l’avait étranglé". "Le tortionnaire a même été fait commandeur de la Légion d’honneur", affirmait le journal le 4 décembre 1997. A l’époque des faits, Paul Aussaresses était responsable des renseignements français à Alger, sous les ordres de Jacques Massu. LE GÉNÉRAL SCHMITT A JUSTIFIÉ L’USAGE DE LA TORTURE EN ALGÉRIE par Franck Johannès [Le Monde, le 29 novembre 2001] Plusieurs témoins sont venus, mardi 27 novembre, défendre l’honneur de Paul Aussaresses. Le général Maurice Schmitt a justifié l’usage de la torture en Algérie au nom de "la légitime défense d’une population en danger de mort". Henri Alleg a, lui, évoqué l’horreur des sévices qu’il a subis après son arrestation, en 1957. Un quarteron de généraux en retraite bat la semelle devant la 17e chambre correctionnelle de Paris. Ils ont une apparence : courbés, chenus, décorés, à moitié sourds, plein de souvenirs et d’arthrite. Mais, en réalité, ils sont prêts comme au premier jour à défendre l’honneur de la patrie, et de leur camarade Paul Aussaresses, poursuivi pour "complicité d’apologie de crimes de guerre" après son livre sur l’Algérie. Au deuxième jour du procès, mardi 27 novembre, chacun est venu donner son grain de sel, y compris un copain restaurateur qui connaît bien le général Aussaresses depuis deux ans. Et la torture, qu’on croyait crime de guerre, est désormais une opinion : le général Schmitt, par exemple, est plutôt pour, dans les cas exceptionnels naturellement. Henri Alleg est, lui, plutôt contre, d’autant qu’il y est passé, et certains de ses amis en sont morts. C’est un petit homme à l’œil vif, de quatre-vingts ans sonnés, qui était directeur d’Alger républicain , un journal vite interdit. Il a été arrêté en juin 1957 chez Maurice Audin, dont on n’a jamais retrouvé le corps, et a été torturé "à l’électricité, par noyade ou plutôt étouffement sous l’eau, avec des torches de papier". Personne n’ose lui demander d’expliquer. "J’entendais hurler, j’entendais les cris des hommes et des femmes pendant des nuits entières, c’est cela qui est resté dans ma mémoire", a raconté le vieux monsieur, resté un mois dans un "centre de tri". Il a passé trois ans en prison, a fait sortir feuille à feuille son livre, La Question, avant d’être condamné à huis clos à dix ans de prison pour "atteinte à la sûreté de l’État. Et association de malfaiteurs, ça me fait toujours rire, mais c’est comme ça". La guerre d’Algérie, "que l’on présentait comme un combat pour notre civilisation, c’était en fait une guerre contre l’indépendance d’un peuple, menée avec les méthodes des occupants nazis". Henri Alleg a expliqué que Larbi Ben M’Hidi, tué par Paul Aussaresses, était le Jean Moulin algérien. "Si un général allemand comparaissait aujourd’hui pour dire comment il avait suicidé Jean Moulin, tout le monde se demanderait pourquoi on le juge seulement pour apologie de meurtres alors qu’il en a commis tellement." Et il a mis en garde les jeunes contre le retour de la torture, "un retour à la barbarie, au nom de la civilisation ou de la lutte contre la barbarie" . Le vieux monsieur a été digne, profond, touchant. Mais il a été communiste, et la salle, assez largement acquise au général Aussaresses, en a frissonné d’indignation. Me Gilbert Collard, pour Paul Aussaresses, a enfoncé le clou en expliquant qu’en 1962 Henri Alleg collaborait à la Pravda : courte manœuvre, tombée à plat, d’autant qu’il avait seulement donné une interview. "PERDRE MON ÂME" Le général Schmitt témoigne au procès Aussaresses, le 27 nov. 2001 © Riss - Charlie Hebdo - 5 déc. 2001 Après un défilé, assez uniforme, des compagnons de Paul Aussaresses à travers les âges, l’autre témoin majeur est venu déposer. Le général Maurice Schmitt, soixante et onze ans, est un calibre : saint-cyrien, prisonnier à Dien Bien Phu, lieutenant au troisième régiment de parachutistes coloniaux à Alger en 1957, il a aussi été chef d’état-major des armées de 1987 à 1991, c’est-à-dire le plus haut responsable militaire de son temps. Et le général ne tourne pas autour du pot : "Les membres du FLN, avant d’être des terroristes, étaient des tortionnaires." Il suggère assez rudement que Louisette Ighilahriz, violée et torturée, a menti et que "tout ceci est une affaire montée". S’il "n’est pas contestable" qu’il y a eu de la torture en Algérie, c’était "de la légitime défense d’une population en danger de mort". Le général Schmitt est d’ailleurs prêt à recommencer : "S’il faut se salir les mains ou accepter la mort d’innocents, a énoncé le militaire, je choisis de me salir les mains au risque de perdre mon âme." D’ailleurs, "si Moulaï Ali -le responsable d’un réseau de poseurs de bombes- n’avait pas parlé, je l’aurais fait parler. Il y a des cas limites ou vous avez le choix entre la mort d’une centaine d’innocents et un coupable avéré". Maurice Schmitt est lui-même accusé d’avoir torturé la jeune Malika Koriche (Le Monde du 29 juin), mais la question lui a été à peine posée et n’intéresse guère le tribunal. Pourtant, a relevé Me Henri Leclerc pour la Ligue des droits de l’homme, le général Massu lui-même s’est interrogé sur la nécessité de la torture. "Massu aurait dû se poser la question quand il était à la tête de la dixième division parachutiste", a répondu rudement le général. La substitut a réclamé 100 000 francs d’amende pour chacun des prévenus, le général Aussaresses et ses éditeurs. Le jugement sera prononcé le 25 janvier. Extraits de l’entretien d’Annie Rey-Goldzeiguer [1] avec Christian Makarian et Dominique Simonnet, publié dans l’Express du 14 mars 2002. [En 1930, la France célèbre le centenaire comme si l’histoire de l’Algérie avait commencé en 1830. On présente les colonies comme des terres à civiliser, à éduquer.] De leur côté, certains Algériens tentent de ranimer l’idée du monde médian. Ils veulent la citoyenneté, l’égalité. En 1936, le Congrès musulman, qui réunit à Alger les forces religieuses et politiques, se déclare en faveur de l’assimilation. A Paris, un projet, connu sous le nom de Blum-Viollette, est élaboré pour donner la citoyenneté à 30 000 personnes. Immédiatement, les colons s’y opposent : manifestations violentes, propagande intensive en France... Blum, alors en situation difficile, préfère renvoyer l’affaire aux calendes grecques. A son tour, le Front populaire a échoué sur la question algérienne. Pourtant, les Algériens l’avaient voulue, cette assimilation, ils en avaient rêvé, ils étaient prêts. Une fois encore, ils doivent déchanter. Une fois encore, l’espoir retombe. Et c’est donc par déception que les Algériens vont commencer à se tourner vers autre chose : l’idée séparatiste. Oui, la déception sera terrible, et la coupure, définitive. L’idée nationaliste est née après la Première Guerre mondiale. Le Parti communiste, d’abord, implanté en Algérie, avait tenté d’organiser les « Nord-Africains » en créant sa section coloniale. Il avait recruté un personnage clef, Messali Hadj, fils de cultivateurs de Tlemcen, qui avait fait son service militaire à Bordeaux et était plein d’admiration pour la société française. Dans la France des années 20, celui-ci a compris que le mot « exploitation », que l’on manie dans les milieux syndicaux, peut s’appliquer non seulement au patron envers son employé, mais aussi au colonisateur envers le colonisé. Messali Hadj va devenir le chef du mouvement algérien l’Etoile nord-africaine, créé en 1926 et, en 1937, devant une immense foule rassemblée dans un stade d’Alger, il prononce pour la première fois le mot d’indépendance. Prenant dans ses mains un peu de terre, il déclare : « Cette terre n’est pas à vendre. C’est la nôtre ! » En mai 1940, quand la France défaite s’enfonce dans le pétainisme, comment réagit l’Algérie ? Pour les Français d’Algérie, c’est d’abord une consternation de convenance. Le mythe de la puissance française s’effondre. Ils pleurent les malheurs de la métropole. Et puis, le choc passé, ils se réjouissent. L’échec, disent-ils, ce n’est pas celui de la France, mais de l’anti-France, du Front populaire, qui menaçait leurs privilèges, de la gauche progressiste, qui avait failli faire leur malheur avec ce projet Blum-Viollette. Tout cela est désormais écarté. Enfin, on va pouvoir rétablir l’ordre colonial ! Travail, famille, patrie... Le monde colonial se pâme d’admiration devant Pétain, ce vieillard qui a su redonner à la France le sens du devoir. Vous voulez dire que les Français d’Algérie se reconnaissent naturellement dans l’idéologie pétainiste ? Exactement. Ils vont pouvoir mettre en pratique ce racisme profond qui est finalement l’unique idéologie pied-noir. Pétain est la « divine surprise ». 95% des Français d’Algérie y adhèrent, y compris ceux de gauche. A l’exception, évidemment, des réprouvés, sanctionnés par le nouveau régime, les communistes, les francs-maçons, les juifs. Le décret Crémieux est aboli. Les juifs perdent brutalement leur citoyenneté. L’historien André Nouschi raconte comment, alors qu’il allait réclamer sa carte d’identité, on lui a appris qu’il n’était plus qu’un « sujet français », un indigène lui aussi, un sous-homme en somme. Un service spécial des affaires juives est créé sous la direction de Pierre Gazagne : les « suspects » sont envoyés dans des camps de travail dirigés par la Légion, employés aux travaux forcés pour la construction du Transsaharien, retenus dans des conditions d’hygiène effroyables, torturés à la moindre peccadille. Les biens et les entreprises juifs sont « aryanisés », confisqués et confiés à des syndics français qui empochent les bénéfices. On interdit même l’école à quantité d’enfants juifs, ce qu’on n’a pas fait en France. Et tout cela est mené avec la bénédiction du clergé. Les Français d’Algérie célèbrent la Révolution nationale du Maréchal, qui les préserve à la fois de l’occupation allemande, de la concurrence juive et du nationalisme arabe ! Quel est alors le sort des musulmans ? Ils ont, bien sûr, versé leur sang aux côtés des soldats français pendant la « drôle de guerre ». Mais la plupart d’entre eux restent spectateurs des événements. Seul Ferhat Abbas, farouche assimilationniste, envoie un mémorandum à Pétain pour lui demander de s’occuper du sort des musulmans. Il reçoit un accusé de réception promettant que le Maréchal se penchera sur la question. En vain. La requête de Ferhat Abbas restera sans suite. En revanche, l’Etat français aura ses musulmans de service, situés au premier plan des manifestations patriotiques et arborant leurs décorations pendantes. Pour l’essentiel, le régime de Vichy fige les choses ; plus rien ne bouge. [...] C’est dans ce contexte que l’Algérie, qui n’a jamais eu d’importance stratégique internationale, va soudain devenir une base essentielle de la Seconde Guerre mondiale. Oui, avec l’arrivée des Américains. Roosevelt a mis sur pied un débarquement en Afrique du Nord pour partir à la conquête de l’Europe par le sud. A première vue, l’Algérie n’est qu’un théâtre d’opérations : le 8 novembre 1942, « Allô, Robert, Franklin arrive », selon le code choisi pour annoncer le débarquement. Mais, en réalité, c’est un événement déterminant pour la suite. Les Français n’ont absolument pas saisi la portée de cette journée. Pendant vingt-quatre heures, il y a des échanges de coups de feu et des victimes : obéissant à Vichy, les Français répliquent comme ils peuvent au déferlement. Mais les combats s’arrêtent très vite. Les Américains n’ont aucun mal à entrer à Alger. Là, c’est la stupeur ! On voit des Noirs et des Blancs marcher ensemble, et on s’étonne devant ces boys décontractés assis sur des drôles de véhicules, les Jeep. Est-ce que vous imaginez le contraste avec une armée française encore équipée de bandes molletières ? Alger est fascinée, d’autant plus que les GI distribuent chewing-gums, chocolat et pain blanc. Derrière ces images, quelle est la réalité profonde ? Pour la deuxième fois en trois ans, la fameuse armée française reçoit une raclée ! Mais, cette fois, cela se passe directement sous les yeux des Algériens. Ils constatent qu’un nouvel occupant vient d’arriver sur leur sol. Au vu et au su de tous, les décisions ne sont plus prises par des Français, mais par des Américains. Les Algériens touchent du doigt la vulnérabilité et l’effondrement français. Une révolution intellectuelle s’opère : les Algériens se mettent à penser que le moment est venu de réagir. Comment vont-ils réagir ? On voit la montée en force de nouvelles figures, comme Lamine Debaghine, jeune et brillant médecin, qui s’impose à la tête du PPA. Le PPA avait été fondé par Messali Hadj en 1937, après la dissolution de l’Etoile nord-africaine - décidée par le gouvernement Blum, eh oui ! pour cause d’idéologie séparatiste. Résultat, le PPA se radicalise et parle d’emblée d’indépendance. Sous l’autorité de Lamine Debaghine, ce parti exprime, dès l’arrivée des Américains, le regret d’avoir manqué une occasion historique en vue de l’indépendance. A partir de là, le PPA n’aura de cesse de revenir sur ce qu’il considère comme une grave erreur. De l’autre côté de l’échiquier algérien, on trouve les « associationnistes » autour de Ferhat Abbas, et les oulémas, le parti religieux, en principe apolitique mais qui va finir par s’investir dans la lutte nationale. Darlan, Giraud, de Gaulle... Après l’arrivée des Américains, une inquiétude s’empare au sommet. Quelle est l’attitude des Algériens face à ce désordre qui saisit le pouvoir ? Le fait de voir les Français s’entre-déchirer, voire s’entre-tuer, achève de discréditer la France et nourrit l’aspiration à l’indépendance. Prenez l’assassinat de Darlan, en décembre 1942. C’est un épisode lamentable. [...] Ajoutez à cela la querelle entre Giraud, qui a l’obsession d’être commandant en chef des armées, et de Gaulle, qui n’est même pas informé du débarquement allié et va se rendre à Alger seulement en mai 1943. Quant aux Américains, leur image de libérateurs s’effrite dès lors qu’ils réquisitionnent les plus belles villas et montrent qu’ils ne manquent de rien alors que la faim sévit dans les rues d’Alger. Tout de même, de Gaulle va rapidement prendre le dessus... Effectivement. Alors que Giraud, imposé à la tête de l’Algérie par les Américains, le reçoit de manière glaciale et exige une réception en catimini, les partisans du Général présents à Alger - notamment Louis Joxe et René Capitant - rassemblent en secret des sympathisants gaullistes. Résultat, de Gaulle fait un triomphe et finit acclamé par la foule. Roosevelt, conscient de la nullité de Giraud, lui envoie Jean Monnet comme éminence grise et lui impose de rétablir la légalité républicaine en échange d’un armement moderne. Giraud s’incline et prononce un discours écrit par Monnet, dans lequel il annonce des mesures démocratiques qui vont immédiatement effrayer les Français d’Algérie. Giraud ne fera pas long feu. Lui succèdent les résistants, fin 1943, qui fondent le CFLN (Comité français de libération nationale). C’est la réapparition des assemblées délibératives, des partis politiques, le retour de leaders venus de France et, surtout, la libération des communistes des camps de concentration du Sud algérien. Dans cette période, qui précède de peu la Libération, est-ce que l’Algérie entre en ligne de compte dans les rangs de la France libre ? Oui, mais pour une seule raison : on a besoin, du point de vue gaulliste, de faire la preuve que la France est encore une grande nation, capable de se relever. Et, notamment, de disposer de nouveau d’une armée puissante. Or les pieds-noirs vont beaucoup contribuer à cette nouvelle armée : les jeunes, en particulier, se sont engagés en masse dans les corps francs d’Afrique, qui vont participer activement à la libération de la Tunisie. La moitié des engagés périront, notamment durant la prise de Bizerte, contre les blindés allemands. Et ce sont eux qui entreront les premiers à Bizerte. Même si les Forces françaises libres, qui s’étaient battues vaillamment en Tripolitaine, en particulier à Bir Hakeim, leur volent la vedette lors du défilé victorieux à Tunis, en mai 1943. L’armée d’Algérie se modernise avec le matériel américain, se gonfle par la mobilisation des jeunes classes des deux communautés ; elle saura s’illustrer sur les théâtres italiens. C’est dans le contexte du retour à la paix que s’enclenche un engrenage particulièrement sanglant. Avec le sursaut français, les autorités d’Alger se montrent de nouveau intransigeantes envers les musulmans. Que se passe-t-il ? Fin avril 1945, le fameux Pierre Gazagne, secrétaire du gouvernement général dirigé par Yves Chataigneau, profite de l’absence de celui-ci pour exiler Messali Hadj et arrêter les dirigeants du PPA, dangereux séparatistes, au moment où la France, ruinée, a besoin de son empire pour revendiquer son titre de grande puissance.... Dès lors, l’atmosphère va se détériorer, jusqu’au drame du 8 mai 1945. Le jour de la victoire des Alliés contre les nazis ! Oui. A Sétif, capitale du nationalisme montant, les Algériens se joignent au défilé des Français qui se rendent vers le monument aux morts. C’est mardi, jour du souk, et un grand nombre de montagnards sont présents. Un jeune ouvrier déploie le drapeau vert-blanc-rouge, symbole de l’indépendance. La police veut s’en emparer et tire. C’est la panique. Les montagnards, qui croient au traquenard, se ruent sur la ville française et massacrent avec des couteaux de boucher et des bâtons. Parmi les victimes, on trouve des modérés du « troisième camp », tels le maire de Sétif, ou Albert Denier, le secrétaire du Parti communiste, qui aura les deux mains tranchées. Et c’est l’escalade. Oui. Le même soir, à Guelma, à 160 kilomètres de là, le commissaire de police Achiari, gaulliste de la première heure, connu pour ses interrogatoires « spéciaux » de militants communistes, à qui de Gaulle a offert le poste de sous-préfet, fait tirer sur les manifestants, arme les Français et les lance dans une répression effroyable : c’est la chasse aux « merles ». L’un des Français dira : « J’ai tué 83 merles. » Peu importent l’âge, le sexe. On tue, on exécute... « Ce sont nos frères qu’on assassine ! » crient les Algériens, qui descendent des montagnes pour épauler leurs frères... La répression va s’étendre à toute région et durer deux mois. L’aviation et la marine françaises bombardent les attroupements au jugé. Il y aura des milliers de victimes. Ces événements ont longtemps été tus en France. On les a volontairement laissés dans l’ombre. A la demande du gouverneur Chataigneau, le commissaire de police Bergé rédigera deux rapports (à Guelma, il a vu de ses yeux les charniers) qui seront ignorés. Peu après, le général Tubert sera envoyé à son tour pour enquêter. Un ordre venu de Paris lui interdira de continuer : il émane du général de Gaulle lui-même ! Le silence se fait. Le Parti communiste se tait lui aussi. A la fin de la guerre d’Algérie, les archives civiles relatant les événements seront expédiées par navires de guerre, puis verrouillés au centre d’Aix-en-Provence. En 1985, grâce au conservateur - qui sera sanctionné pour cette initiative - j’ai pu consulter les rapports de Bergé : c’est le document le plus bouleversant que j’ai jamais lu de toute ma vie de chercheur. Quant aux archives militaires, partiellement ouvertes en 1990, elles ont été nettoyées : la correspondance du général Raymond Duval, commandant de la division du Constantinois en 1945, a été tronquée de la période du 8 au 11 mai. Nous ne sommes toujours pas capables de regarder notre histoire en face. Les événements de 1945 ont lourdement pesé dans les années suivantes. Bien sûr ! Car avec eux disparaît tout espoir de réconciliation entre les deux communautés. Le jour où la Seconde Guerre mondiale se termine, en voyant les chapelets de bombes lancées par l’armée française sur la Petite Kabylie, en entendant les bruits sourds des canons de marine, on comprend en Algérie que toutes les illusions sont perdues. Entre Français et Algériens, il y a désormais un flot de sang. Tout est fini. Le « monde du contact », c’est une utopie. Ce jour-là, en leur for intérieur, nombre d’Algériens décident de se battre pour l’indépendance. C’est en fait le vrai début de la guerre d’Algérie. Absolument. La guerre d’Algérie a commencé le 8 mai 1945. torture : ce que j’ai vu en Algérie, par Jacques Julliard article de la rubrique les deux rives de la Méditerranée > la guerre d’Algérie date de publication : vendredi 6 janvier 2006 Si nous voulons empêcher le retour de cette honte, il faut la regarder en face. Il ne faut pas que les fils retrouvent un jour l’horreur sur leur chemin parce que leurs pères auront menti. [Article publié dans le Nouvel Observateur N° 1884, du 14 décembre 2000] Ma première rencontre avec la torture au cours de la guerre d’Algérie fut en quelque sorte pédagogique. J’étais alors élève officier à l’école militaire de Cherchell, au titre de l’instruction militaire obligatoire (IMO) qui obligeait les élèves des grandes écoles - pour moi, l’Ecole normale supérieure - à faire leur service comme aspirants officiers, puis comme sous-lieutenants. En février 1960, nous fûmes envoyés à Arzew, petite ville côtière à l’est d’Oran, pour un stage de formation à la guérilla, au tir instinctif, aux actions commando. C’est durant un cours sur le renseignement que l’incroyable se produisit et que l’innommable fut nommé. L’officier instructeur, un capitaine dans mon souvenir, se lança tout bonnement dans une leçon sur la torture devant quelque 150 élèves officiers médusés. Il y fallait un local discret, en sous-sol de préférence, propre à étouffer les bruits. L’équipement pouvait être sommaire : un générateur de campagne couramment appelé "gégène", l’eau courante, quelques solides gourdins. Cela suffisait. Il s’adressait à des garçons intelligents, ils comprendraient... A la sortie, des groupes se formèrent. Nous avions beau être sans illusions, c’était trop, un pas supplémentaire venait d’être franchi. Je fis partie de la délégation qui demanda à être reçue par le colonel commandant le camp. Nous lui fîmes part de notre indignation : de telles instructions étaient contraires au code militaire et à l’honneur. Je me rappelle avoir ajouté que nous envisagions une lettre au "Monde", pour faire connaître l’incident. La lettre au "Monde" était alors une arme absolue. Le colonel nous déclara immédiatement qu’il s’agissait d’un regrettable débordement, d’une initiative personnelle de l’instructeur. Le jour même, il réunit tous les élèves pour faire une mise au point qui prit la forme d’un désaveu et même d’excuses. De telles paroles étaient en effet contraires au code militaire et ne se renouvelleraient pas. Nous restâmes sceptiques sur ce dernier point mais c’était une victoire psychologique, y compris sur ceux parmi nous qui ne réprouvaient pas le capitaine, au nom de l’éternel argument qui veut que l’on ne fasse pas d’omelette sans casser des oeufs. Les oeufs étaient des hommes et, surtout, pour quelle omelette ? Les discussions se poursuivirent les jours suivants, notamment avec le lieutenant qui dirigeait notre section depuis Cherchell. Beaucoup d’autorité et de stature, de la culture, le visage et le corps couturés de cicatrices reçues au combat, il jouissait chez nous d’un grand prestige. Ce baroudeur, qui était aussi un chrétien convaincu, nous déclara qu’il n’avait jamais pratiqué la torture, ne la pratiquerait jamais, et que l’on pouvait faire cette guerre sans se déshonorer. J’ai plaisir à citer le nom de cet officier qui est resté mon ami, et qui devait ensuite commander les forces de l’ONU au Liban, où il fut de nouveau blessé : c’est le général Jean Salvan. Les noms des autres, je les ai oubliés. "L’histoire montre que la torture a existé avant le terrorisme et qu’elle est inefficace Ma seconde rencontre avec la torture fut infiniment plus dramatique. A quelques semaines de là, je rejoignis l’unité à laquelle j’étais affecté sur un piton éloigné de tout, dans la montagne kabyle. A l’issue du repas d’accueil, au cours duquel se déroulèrent les blagues habituelles en pareille circonstance (inversion des grades entre le capitaine et son ordonnance, incidents factices, récits effrayants de la guerre), on me demanda en guise de dessert si, comme dans " les Plaideurs ", je ne voulais pas " voir donner la question ". On interrogeait une vieille femme soupçonnée d’en savoir long. Je refusai avec horreur. " Dommage, me répondit le capitaine, je pensais à vous comme officier de renseignement ! " Le soir, je rejoignis ma chambre, une soupente dans une mechta kabyle, à laquelle on accédait par une échelle. Au pied de celle-ci, il n’y avait pas d’électricité bien sûr, je trébuchai sur une masse informe. C’était, enveloppé dans des guenilles, le corps de la vieille femme que l’on avait abandonné là. Au matin, le cadavre avait disparu. Toute ma vie, je me suis demandé si je n’aurais pas dû accepter d’assister à la séance. Peut-être la femme aurait-elle eu la vie sauve. Aux moralistes de trancher. Cette nuit-là, bouleversé, impuissant, je me fis à moi-même le serment absurde de ne jamais faire de politique. De la recherche, du syndicalisme, du journalisme, mais pas de politique ! Pour moi, c’était une évidence : les vrais auteurs de ce meurtre, ce n’étaient pas les bourreaux, c’étaient les hommes politiques qui nous avaient envoyés là, et notamment Guy Mollet et la SFIO. Depuis, j’ai eu beaucoup d’amis au Parti socialiste : il faut qu’ils sachent que jusqu’à mon dernier souffle, je ne serai jamais en paix avec leur parti ni avec François Mitterrand. La torture, mais de façon "modérée" et contrôlée Mon troisième contact avec la torture fut moins désespérant. A quelques mois de là, je fus envoyé, toujours en Kabylie mais sur la côte, dans une autre unité où je fus chargé de l’encadrement de chefs de villages ralliés. On était à l’automne 1960 et, à la suite de l’opération "Jumelles", la Kabylie était beaucoup plus calme. On ne dira jamais assez que dans la révolte d’une partie des officiers contre de Gaulle, l’année suivante, il y avait le sentiment qu’on leur avait volé leur victoire après leur avoir fait pratiquer une guerre sale et compromettre des milliers de harkis qui le paierait de leur vie. Eux aussi allaient connaître la torture. A l’automne de 1960, il y avait quelques combats, quelques prisonniers aussi. Le commandant P. qui commandait l’unité où je venais d’être détaché, était un ancien déporté de Dachau, où il avait connu Edmond Michelet, auquel il vouait un véritable culte. Cela ne l’empêchait pas de faire ou de laisser pratiquer la torture mais de façon "modérée" et contrôlée. Nous en avons parlé des soirées entières, entre deux parties de tarot dont il était, autant que moi, un passionné. Un soir où nous avions fait deux prisonniers, je lui demandai : "Naturellement, vous allez les interroger ? - Il le faut bien... - Croyez-vous qu’Edmond Michelet approuverait cela ?" Le commandant P. ne me répondit pas mais changea de visage. Le lendemain, comme je le croisai au mess, il me jeta négligemment "Vous savez, vos deux fellaghas, on ne leur a rien fait". Ce fut à mon tour de ne pas répondre. Je n’ai jamais revu le commandant P., mais je sus que c’était un homme honnête et si, par hasard, il tombe sur ces lignes et s’y reconnaît, qu’il y trouve aussi mes amitiés. Edmond Michelet est mort en 1970. Après avoir sauvé tant de vies à Dachau, il en avait sauvé encore comme garde des Sceaux sous de Gaulle. Jean-Marie Domenach écrivit alors que Michelet était un saint laïque et qu’il fallait le canoniser. Puisqu’il faut, dit-on, pour cela trois miracles, je lui dis que j’en avais au moins un à sa disposition... Tant de choses qu’il faudrait maintenant dire ou raconter La vie, alors, tenait à peu de chose et à de grands hasards. Dans cette même unité, quelque temps avant mon arrivée, s’était déroulée la scène suivante. Le commandant fait venir un sergent et lui dit : "Prenez huit hommes avec vous et descendez le prisonnier à la ferme B" (c’était la base arrière de l’unité). Le sergent salue réglementairement et s’en va. Puis revient sur ses pas. "Mon commandant, non, décidément je ne veux pas faire ce sale boulot. - Quel sale boulot ? - Eh bien "descendre" un prisonnier ! Vous n’avez pas le droit de me demander cela ! - Imbécile ! Je ne t’ai pas dit de le descendre tout court, mais de le descendre à la ferme !" Celui-là faillit mourir à cause d’un jeu de mots. Si j’étais romancier, j’en aurais fait une nouvelle dans le goût du "Mur" de Sartre. Cela prouve en tout cas que la liquidation des prisonniers, la fameuse "corvée de bois", était chose assez banale et assez courante pour expliquer la méprise du sergent. Je n’accable pas, on le voit, les militaires, fussent-ils à l’occasion des tortionnaires. Tous n’étaient pas des barbares. Loin de là. J’ai passé des nuits à discuter avec des officiers paras, ou des légionnaires. Ils ne me traitaient pas de "gonzesse" ou de "pédé" parce que je leur disais réprouver absolument la torture. Beaucoup disaient me comprendre. Je ne fais pas le malin. Je ne cherche pas à me donner le beau rôle, loin de là. Tout cela n’est pas brillant et, comme tous mes camarades, j’ai pendant quarante ans enfoui mes souvenirs. La torture a ceci de commun avec le viol qu’elle donne un sentiment de salissure à ceux qui la subissent ou même à ceux qui la combattent presque autant qu’à ceux qui la pratiquent. Tant de choses qu’il faudrait maintenant dire ou raconter. Les crimes des nationalistes algériens contre les "colons", contre les Algériens eux-mêmes, contre les harkis. Ces crimes qui continueront, comme on le voit aujourd’hui en Algérie, aussi longtemps que le pouvoir algérien ne les aura pas reconnus. Cela ne suffira peut être pas, mais aussi longtemps que l’Algérie ne regardera pas en face ses propres crimes, elle ne connaîtra pas la paix. Dire la vérité, la vérité politique sur la torture Je reviens aux crimes de l’armée française, ceux que nous avons commis. Directement ou indirectement, ils sont l’oeuvre du pouvoir politique. La preuve, c’est que le contingent ne se révolta jamais contre la torture - elle faisait partie à leurs yeux du mandat implicite et inavouable de la nation - mais qu’il se leva comme un seul homme contre le putsch des généraux, en 1961. Quand je demandais aux appelés pourquoi cette différence de comportement, tous me répondaient : dans le premier cas, on nous fait faire un sale boulot, c’est tout. Dans le second, on veut nous couper de la nation, de nos parents, de nos amis, de nos fiancées... Voilà pourquoi je ne demande pas le jugement des militaires, même les plus compromis. Mais je demande fermement et sans hésitation que le pouvoir politique reconnaisse solennellement que c’est la France qui est responsable, que c’est elle qui a torturé en Algérie. L’histoire, dit Renan à propos de la mort de Jésus, a oublié le nom des bourreaux mais elle a retenu celui du magistrat responsable. C’est de Ponce Pilate qu’il s’agissait alors. Ici, du pouvoir politique. Mon seul souci dans cette affaire est de comprendre comment un peuple civilisé peut retomber dans la barbarie. Si nous voulons empêcher le retour de cette honte, il faut la regarder en face. Dire la vérité, la vérité politique sur la torture. Nous ne voulons pas que les fils retrouvent l’horreur sur leur chemin et la honte au fond de leur coeur, tout cela parce que leurs pères ont menti. Jacques Julliard
la guillotine et la guerre d’Algérie article de la rubrique les deux rives de la Méditerranée > la guerre d’Algérie date de publication : mercredi 23 juillet 2008 Pendant la guerre d’indépendance algérienne, de 1954 à 1962, au nom de la lutte contre la “subversion” du FLN, au nom du rattachement de l’Algérie à la France qui interdisait d’y appliquer le droit de la guerre et de considérer les nationalistes comme des combattants, plus de 1 500 condamnations à mort furent prononcées par la justice française. En 2001, après avoir pu consulter le “registre des grâces” qui répertoriait les noms des condamnés à mort, deux journalistes parvenaient au total de 222 militants du FLN exécutés entre 1956 et 1962, « le plus souvent au terme d’une parodie de justice ». Vous trouverez ci-dessous leur article, publié dans Le Point en août 2001, qui met en évidence l’utilisation politique qui a été faite de la peine de mort au cours de cette guerre. Il est suivi d’un entretien avec Abdelkader Guerroudj, ancien dirigeant du PCA, condamné à mort pour atteinte à la sécurité de l’État, qui put échapper au couperet, tout comme sa femme Jacqueline, grâce à la mobilisation de l’opinion. La même année, l’historienne Sylvie Thénault, dont le travail de recherche porte sur l’histoire de la décolonisation et de la justice, publiait un ouvrage important issu de sa thèse, Une drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie [ST]. Vous trouverez ci-dessous une interview de Sylvie Thénault datant d’août 2001. http://taddart.free.fr
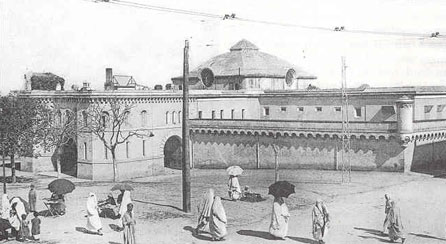
La prison Barberousse d’Alger à l’époque coloniale. Au matin du 19 juin 1956, dans la cour de la prison Barberousse, à Alger, le couperet de la guillotine tombe sur le cou de Mohamed Ben Zabana, un ouvrier soudeur de trente ans. Le militant, rendu infirme par plusieurs blessures, est livré au bourreau malgré l’intervention désespérée de l’archevêque d’Alger, Mgr Duval, auprès du ministre résident, Robert Lacoste — la dernière lettre qu’il adressa à ses parents est reprise sur ce site. Le même jour tombe la tête d’Abdelkader Ferradj, trente-cinq ans. Ce sont les deux premiers martyrs de la cause algérienne. Il y en aura d’autres, beaucoup d’autres, tout au long de la guerre, condamnés à mort et exécutés par la justice de la République. Tous Algériens, excepté quatre membres de l’OAS — ils furent fusillés —, et le " rebelle " Fernand Iveton, militant du Parti communiste algérien, accusé d’avoir déposé une bombe dans le vestiaire de l’usine à gaz d’Alger après le départ du personnel et exécuté le 14 février 1957.
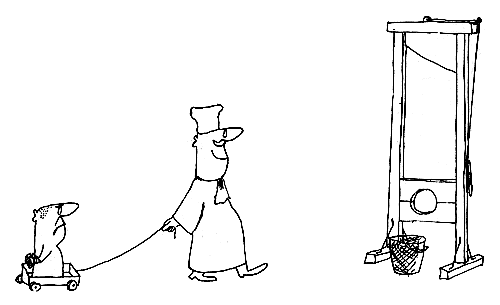
[1] © Siné Les guillotinés de Mitterrand par François Malye et Philippe Oudart, Le Point, N° 1511 du 31 août 2001 Le 9 octobre 1981, François Mitterrand obtenait l’abolition de la peine de mort. Vingt-cinq ans plus tôt, ministre de la Justice du gouvernement de Guy Mollet, il approuvait les premières exécutions capitales de militants du FLN. L’examen d’archives inédites de la chancellerie, que Le Point a pu consulter, montre que Mitterrand, dans la majorité des cas, donna un avis défavorable à la grâce de ces condamnés. « Avis défavorable au recours » ou encore « Recours à rejeter » : ces deux formules tracées à l’encre bleue ont la préférence de François Mitterrand quand, garde des Sceaux, il décide de donner un avis défavorable au recours en grâce des condamnés à mort du FLN dont les dossiers lui sont soumis. René Coty, président de la République - et décideur ultime -, préfère barrer d’un long trait noir la première page du formulaire administratif et indiquer sur l’autre, d’une écriture ronde d’enfant, qu’il laissera « la justice suivre son cours ». Des expressions qui reviennent tout au long des dossiers de condamnés à mort exécutés durant la guerre d’Algérie que Le Point, au bout de quatre mois d’enquête, a pu consulter. Pour y avoir accès, il aura fallu obtenir deux dérogations auprès de la direction des Archives de France. La première a permis de consulter le « Registre des grâces », dans lequel sont couchés, à partir de 1950, les noms de l’ensemble des condamnés à mort. La deuxième a ensuite donné accès à 141 dossiers de condamnés exécutés : les 45 premiers de la guerre d’Algérie - période durant laquelle François Mitterrand administrait la justice - et 96 autres, principalement à d’autres époques de ce conflit, mais aussi quelques droits communs, qui perdirent la tête en métropole ou aux confins de l’empire durant les mêmes années. Le but ? Comparer l’ensemble de ces documents et déterminer exactement quel fut le rôle de François Mitterrand, ministre de la Justice, celui qui, vingt-cinq ans plus tard, allait obtenir l’abolition de la peine de mort. Mais le plus surprenant, c’est surtout la minceur de ces dossiers liés à la guerre d’Algérie : lorsqu’on les voit pour la première fois, entassés sur la longue table de bois clair du service des archives de la chancellerie, on constate rapidement qu’il faut empiler au moins une vingtaine d’exécutions capitales en Algérie pour obtenir un dossier aussi épais que celui d’un obscur droit commun de métropole. Quelques feuillets, deux ou trois bristols griffonnés de mains illustres ont donc suffi à mener, le plus souvent au terme d’une parodie de justice, 222 hommes à la mort en cinq ans. Ce chiffre - également inédit - est considérable. Il représente le quart de l’épuration officielle de la Seconde Guerre mondiale, et donne à lui seul la mesure du mensonge qui a entouré cette période. Mais revenons à François Mitterrand : en Algérie, on est en pleine rébellion quand, à 39 ans, il prend ses fonctions de ministre de la Justice, le 2 février 1956, dans le gouvernement de Guy Mollet. C’est un homme politique confirmé, qui a déjà assumé sept portefeuilles ministériels depuis la fin de la guerre. Il connaît bien le problème algérien, puisqu’il était ministre de l’Intérieur quand l’insurrection a éclaté, quinze mois plus tôt, le 1er novembre 1954. Sa réaction d’alors est connue : « L’Algérie, c’est la France [...] ceux qui veulent l’en dissocier seront partout combattus et châtiés » [2], dira-t-il. Attention, derrière ces déclarations à l’emporte-pièce, il y a aussi un homme qui a tenté une courageuse réforme de la police en Algérie, visant à muter en métropole les policiers les plus durs envers les musulmans. Mais quand François Mitterrand revient aux affaires, il sait qu’il va falloir donner des gages aux Européens d’Algérie. Ceux-ci, excédés par les actions du FLN, ne demandent qu’une chose : des têtes. Car, si de nombreuses condamnations à mort ont été prononcées, aucune n’a encore été exécutée. La première concession intervient cinq semaines plus tard, sous la signature de quatre ministres, dont François Mitterrand : le 17 mars 1956 sont publiées au Journal officiel les lois 56-268 et 56-269, qui permettent de condamner à mort les membres du FLN pris les armes à la main, sans instruction préalable. Pourtant avocat de formation, François Mitterrand accepte d’endosser ce texte terrible : « En Algérie, les autorités compétentes pourront [...] ordonner la traduction directe, sans instruction préalable, devant un tribunal permanent des forces armées des individus pris en flagrant délit de participation à une action contre les personnes ou les biens [...] si ces infractions sont susceptibles d’entraîner la peine capitale lorsqu’elles auront été commises. » Du coup, le nombre des condamnations à mort va s’envoler. Il y en aura plus de 1 500 durant les « événements ». Car il ne s’agit pas d’une guerre et on ne reconnaît pas le statut de combattant aux militants du FLN. Ils sont jugés comme des criminels. Mais, à Alger, en ce printemps de 1956, on ne se contente plus de mots. Et le 19 juin, les deux premiers « rebelles » sont conduits à l’échafaud. Comment ont-ils été choisis parmi les quelque 150 hommes déjà condamnés ? Le 14 janvier 1998, Sylvie Thénault, historienne, a interrogé dans le cadre de sa thèse [ST] Pierre Nicolaï, à l’époque directeur du cabinet de François Mitterrand : « Pierre Nicolaï témoigne aujourd’hui, écrit-elle, que la décision d’exécuter a été une "décision politique" et qu’il lui fut demandé de choisir parmi les dossiers de recours en grâce un "type" mêlant "crapulerie" et "politique", "un type particulièrement épouvantable" pour "inaugurer la série des exécutions" sans déclencher trop de polémiques. » Le premier condamné, Abdelkader Ferradj, 35 ans, est un goumier déserteur qui a participé, au sein du commando Ali Khodja, à l’embuscade dressée contre un car de tourisme et deux voitures particulières le 25 février 1956. Six Européens ont été tués, dont une petite fille de 7 ans, Françoise Challe. Pour le « politique », difficile de fournir martyr plus idéal à la révolution algérienne que Mohamed Ben Zabana. Cet ouvrier soudeur de 30 ans est un vieux routier des geôles françaises, dans lesquelles il a passé trois années entre 1950 et 1953 pour ses activités nationalistes. Mais si Mgr Duval, l’archevêque d’Alger, demande à Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, de suspendre l’exécution, c’est pour une autre raison : « C’est un infirme que vous allez exécuter » [3], plaide-t-il. Zabana a en effet été capturé lors d’un accrochage près de Saint-Denis du Sig, le 8 novembre 1954, une semaine après le début de l’insurrection. Une balle lui a fracassé l’épaule gauche, une autre l’a touché à la jambe, et, comme il ne voulait pas être pris, il s’est tiré une balle dans la tempe qui, ressortant par son oeil gauche, ne l’a pas tué. Les représailles du FLN C’est sa tête que fera tomber la première le bourreau d’Alger à 4 heures du matin, ce 19 juin 1956, dans la cour de la prison de Barberousse, à Alger. Celle d’Abdelkader Ferradj suit sept minutes plus tard. « Ces premières exécutions, cela signifiait la guerre totale, sans cadeaux ni d’un côté, ni de l’autre », témoigne aujourd’hui, à Alger, Abdelkader Guerroudj, condamné à mort en tant que chef du Parti communiste algérien, rapidement passé au FLN. Sur 45 dossiers d’exécutés lors de son passage Place Vendôme, François Mitterrand ne donne que sept avis favorables à la grâce (six autres avis étant manquants). A titre de comparaison, Robert Lacoste, ministre résident en Algérie, qui passait pour un homme très dur, a été plus clément : sur 27 de ces exécutions, il a émis 11 avis favorables au recours en grâce, les 7 autres avis ne figurant pas dans les dossiers. Chacune de ces exécutions va pourtant peser très lourd. Car le FLN a prévenu : si des condamnés à mort sont guillotinés, il y aura des représailles. Dans Le temps des léopards, deuxième des quatre tomes qui constituent La guerre d’Algérie, bible sur cette période, Yves Courrière retrace ainsi la vengeance du FLN et les ordres donnés à ses différents chefs : « Descendez n’importe quel Européen de 18 à 54 ans ; pas de femmes, pas de vieux. » En dix jours, 43 Européens vont être tués ou blessés par les commandos du FLN. L’escalade est immédiate : bombes des ultras européens contre un bain maure rue de Thèbes qui tuera 70 musulmans (mais qui ne donnera lieu à aucune poursuite), bombes et assassinats du FLN, exécutions capitales à Oran, Constantine, Alger. 1957 : la guillotine s’emballe Mais François Mitterrand tient bon. Pourtant, dès le 22 mai 1956, Pierre Mendès France, en désaccord avec la politique algérienne de Guy Mollet, a démissionné du gouvernement ; Alain Savary claque la porte le 22 octobre, au lendemain du détournement de l’avion qui transporte Ben Bella et quatre autres leaders du FLN de Rabat à Tunis. Le 7 janvier 1957, un autre pas est franchi par le gouvernement auquel appartient François Mitterrand : il donne tous pouvoirs au général Massu et à sa 10e division parachutiste pour briser le FLN d’Alger. Les militaires gagneront la « bataille d’Alger », mais on sait à quel prix : torture systématique et plus de 3 000 exécutions sommaires. La guillotine, elle, s’emballe : « Chiffre jamais atteint jusqu’ici, 16 exécutions capitales ont eu lieu en Algérie du 3 au 12 février », écrit France-Observateur. « Il y a eu une déviation de la justice, explique Jean-Pierre Gonon, alors jeune avocat du barreau d’Alger. L’instruction était inexistante et, avec la torture, on parvenait à faire avouer n’importe quoi à n’importe qui. » Le 11 février, pour la première fois, un « rebelle » européen est guillotiné : Fernand Iveton, tourneur à l’EGA, l’usine de gaz d’Alger, militant communiste condamné à mort pour avoir déposé une bombe qui n’a pas explosé, est exécuté avec deux autres condamnés, Mohamed Lakhnèche et Mohamed Ouenouri. On ne connaîtra pas l’avis donné par François Mitterrand, le dossier n’ayant jamais été versé aux archives... Enfin, le 14 février, il signe avec trois autres ministres une loi qui permet d’accélérer les recours en grâce. Quand il quitte son bureau de la place Vendôme, le 21 mai 1957, le gouvernement de Guy Mollet cédant la place à celui de Maurice Bourgès-Maunoury, 45 condamnés à mort ont été exécutés en seize mois.
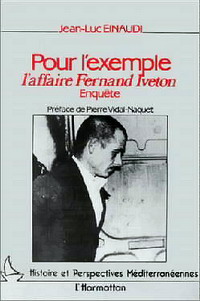
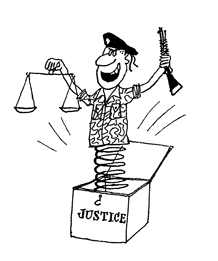
Afin,d'enrichir le contenu de document envoyer un message à l'email suivant: Envoyer un message Merci d'avance.